
© Alix Le Brozec
Suite au succès de la deuxième édition, l'éditeur du magazine Compétence Photo propose la troisième mouture entièrement mise à jour du livre Droit à l'image et droit de faire des images, de Me Joëlle Verbrugge, édité dans la collection Les Guides Compétence Photo. L'auteure y traite des nombreux aspects liés à cette problématique.

PRÉVENTES • FRAIS DE PORT OFFERTS JUSQU'AU 20 DÉC.
>> CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER CE LIVRE <<
568 pages • 35 €
À télécharger :
• SOMMAIRE COMPLET
• UN EXTRAIT DU LIVRE
• MODÈLES D'AUTORISATIONS D'UTILISATION D'IMAGE
>> CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER CE LIVRE <<
568 pages • 35 €
À télécharger :
• SOMMAIRE COMPLET
• UN EXTRAIT DU LIVRE
• MODÈLES D'AUTORISATIONS D'UTILISATION D'IMAGE
La troisième édition de « Droit à l’image et droit de faire des images » vient de sortir. La précédente datait de 2018 déjà. Commente cette matière évolue-t-elle ?
Le droit est une science humaine, et non une science exacte. Dès lors, il évolue avec la société (mentalités, technologies, etc.). Au fur et à mesure qu’évoluent les mentalités – et pas toujours dans le bon sens – de nouvelles pratiques photographiques sont imaginées, et créent de nouvelles difficultés juridiques. Il revient alors aux tribunaux de contenir certains débordements, ce qui donne lieu à des évolutions progressives sur certains sujets.
À cela s’ajoutent les initiatives du législateur, soit en réaction à certaines jurisprudences, soit de façon spontanée.
Tout ceci explique que les évolutions sont souvent lentes en matière de droit à l’image. Pour un ouvrage juridique, cinq ans entre deux éditions est une période assez longue… Mais cela me permet d’avoir une vue globale.
À cela s’ajoutent les initiatives du législateur, soit en réaction à certaines jurisprudences, soit de façon spontanée.
Tout ceci explique que les évolutions sont souvent lentes en matière de droit à l’image. Pour un ouvrage juridique, cinq ans entre deux éditions est une période assez longue… Mais cela me permet d’avoir une vue globale.
Qu’en est-il de la jurisprudence en la matière ?
Les juges continuent à tracer les limites de ce qui est autorisé en matière de publication de l’image d’une personne ou d’un bien, en affinant au fil des litiges qui leur sont soumis. L’évolution n’est pas toujours uniforme, il peut y avoir certains errements, mais de façon globale les grands principes dégagés depuis la deuxième édition sont restés identiques. Les jurisprudences que j’ai ajoutées à cet égard viennent apporter des précisions.
J’ai donc, de mon côté, supprimé certaines décisions utilisées à titre d’illustration pour les remplacer par de plus récentes lorsqu’elles allaient exactement dans le même sens, ou ajouté de nouveaux exemples lorsqu’ils apportent une pierre supplémentaire à l’édifice qui se construit peu à peu.
J’ai donc, de mon côté, supprimé certaines décisions utilisées à titre d’illustration pour les remplacer par de plus récentes lorsqu’elles allaient exactement dans le même sens, ou ajouté de nouveaux exemples lorsqu’ils apportent une pierre supplémentaire à l’édifice qui se construit peu à peu.
Quelles sont les principales nouveautés de cette troisième édition ?
Les nouveautés sont surtout à chercher du côté du législateur. Dans le but de protéger les enfants, par exemple, différentes nouvelles dispositions ont été votées, pour certaines, ou amorcées pour d’autres. Nous avons vu aussi des tentatives de légiférer sur la question de l’image des forces de l’ordre. J’en rappelle l’évolution globale.
Nous avions amorcé aussi la question de la liberté de panorama dans la deuxième édition de l’ouvrage. Elle se complète aujourd’hui avec la fin d’un procès-fleuve et déjà une première jurisprudence appliquant les dispositions intégrées en 2016 dans le Code de la propriété intellectuelle.
Dans le Chapitre 4 consacré aux dispositions spécifiques à certains types d’image, j’ai également ajouté différentes sections, soit parce que le législateur a créé de nouvelles interdictions, soit en ajoutant des dispositions qui préexistaient, lorsque je me suis aperçue, dans certains dossiers ou lors de conférences, que des questions étaient posées par ces législations ponctuelles.
J’essaie en effet toujours de rester au plus proche de la pratique des photographes et des utilisateurs d’images, et les contacts que je peux avoir avec certaines agences de communication me permettent d’affiner les besoins de chacun, au fil des éditions.
Nous avions amorcé aussi la question de la liberté de panorama dans la deuxième édition de l’ouvrage. Elle se complète aujourd’hui avec la fin d’un procès-fleuve et déjà une première jurisprudence appliquant les dispositions intégrées en 2016 dans le Code de la propriété intellectuelle.
Dans le Chapitre 4 consacré aux dispositions spécifiques à certains types d’image, j’ai également ajouté différentes sections, soit parce que le législateur a créé de nouvelles interdictions, soit en ajoutant des dispositions qui préexistaient, lorsque je me suis aperçue, dans certains dossiers ou lors de conférences, que des questions étaient posées par ces législations ponctuelles.
J’essaie en effet toujours de rester au plus proche de la pratique des photographes et des utilisateurs d’images, et les contacts que je peux avoir avec certaines agences de communication me permettent d’affiner les besoins de chacun, au fil des éditions.
Cet ouvrage concerne-t-il uniquement les photographes ?
Pas du tout. Aux photographes et vidéastes qui sont les principaux lecteurs s’ajoutent de plus en plus souvent des éditeurs de presse, des organisateurs d’événements, des agences de presse ou de communication ainsi que des organismes de formation, et de plus en plus de juristes et avocats. Le caractère systématique de l’examen des règles en vigueur et les explications plaisent à tous, semble-t-il, et les références de jurisprudence et de doctrine citées aident et facilitent la vie des juristes et avocats. Je suis ravie d’élargir ainsi mon lectorat, ce qui permet aussi de belles rencontres et des échanges d’idées réguliers avec certains lecteurs.
Cet ouvrage répond-il uniquement aux problématiques liées au droit français ?
Dans cette édition, j’ai fait le choix de me concentrer sur le droit français. En effet, les législations deviennent de plus en plus complètes, d’une part, et complexes, d’autre part. Synthétiser en quelques pages des systèmes étrangers s’avère de plus en plus difficile, et leur pratique quotidienne est indispensable pour déceler les évolutions prévisibles. Pour offrir un contenu parfaitement à jour au moment de la sortie de l’ouvrage, incluant aussi des indications sur les évolutions à venir, il était donc indispensable de me concentrer sur ce que je pratique de façon régulière. Pour cette raison, l’ouvrage est donc centré sur le droit français.

PRÉVENTES • FRAIS DE PORT OFFERTS JUSQU'AU 20 DÉC.
>> CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER CE LIVRE <<
568 pages • 35 €
À télécharger :
• SOMMAIRE COMPLET
• UN EXTRAIT DU LIVRE
• MODÈLES D'AUTORISATIONS D'UTILISATION D'IMAGE
>> CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER CE LIVRE <<
568 pages • 35 €
À télécharger :
• SOMMAIRE COMPLET
• UN EXTRAIT DU LIVRE
• MODÈLES D'AUTORISATIONS D'UTILISATION D'IMAGE









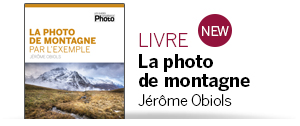
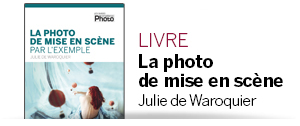
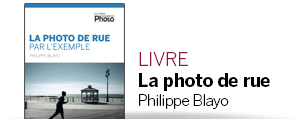

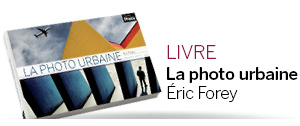
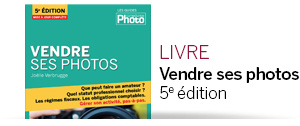


 Télécharger le sommaire complet
Télécharger le sommaire complet


